Assurer la qualité et l'équité de l'enseignement au Luxembourg!

PISA et PIRLS - matière à analyse!
La publication des résultats des études PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 1 et PISA (Programme for International Student Assessment) 2 en décembre de l'année passée a donné lieu dans la presse luxembourgeoise à la question standard de l'efficience de notre système scolaire. De même une délégation du secrétariat de l'OCDE, - l'organisation à l'origine de l'étude PISA, - qui était en mission économique au Luxembourg à ce moment n'a pas manqué l'occasion pour opposer le coût élevé du système à ses résultats médiocres.
Une telle question fait évidemment sursauter l'enseignant qui s'acquitte sérieusement de sa tâche - sans obtenir nécessairement les résultats espérés - et qui constate que son salaire n'est nullement supérieur à celui des personnes du même niveau d'études. Elle peut en effet lui suggérer qu'il ne mériterait pas l'argent qu'il gagne et cela le blesse profondément. N'empêche qu'il faut accepter d'aborder la question de l'efficience d'un point de vue critique, non seulement pour faire barrage à une argumentation simpliste, mais aussi et surtout parce que l'éducation et la formation sont des questions-clés pour l'avenir. Or, il me semble que ceux qui connaissent le système de l'intérieur et qui sont les professionnels de la formation des jeunes sont les mieux placés pour interpréter les chiffres et proposer des solutions.
Disons d'emblée que le SEW n'a pas attendu l'étude PISA pour mettre en exergue l'iniquité qui caractérise notre système scolaire et pour exiger de profondes réformes. Rappelons à ce sujet le document «Investir dans une politique d'éducation et de formation offensive» 3 datant de la Conférence éducation et formation de l'OGBL d'octobre 1998 et qui contient de nombreuses propositions qui restent d'une actualité brûlante. Il faut noter que nous nous sommes trouvés à ce moment assez isolés pour exiger une qualification élevée du plus grand nombre possible et on nous posait fréquemment la question, qui ferait donc le travail «sale» si tout le monde avait le bac.
Je constate que les résultats décevants de la 1re étude PISA furent en quelque sorte un choc salutaire, puisqu'ils incitaient à une certaine modestie face à d'autres pays réussissant à qualifier plus d'élèves à un niveau plus élevé et qu'ils suscitaient une réforme de l'enseignement des langues au Luxembourg, essentiellement basé sur l'écrit. Ils suggéraient aussi une plus grande ouverture d'esprit pour des contenus dépassant l'accumulation de savoirs factuels et pour des méthodes différentes de l'enseignement traditionnel ex cathedra à longueur de journée. Ces premiers résultats montraient également que l'influence de la situation socio-économique sur le niveau de compétence n'était nulle part aussi marquée qu'au Luxembourg, ce qui a incité le SEW à coopérer dès 2004 avec l'ASTI dans le «Pôle pour une école démocratique» avec l'objectif d'agir en faveur d'une meilleure égalité des chances dans l'enseignement luxembourgeois.
Faire ces constatations ne signifie pas pour autant accepter l'argumentation et la logique des instigateurs du test PISA: pour l'OCDE, il s'agit avant tout de mettre l'École au pas des besoins de l'économie et des entreprises, de renforcer l'efficacité de la main-d'oeuvre et d'instaurer la concurrence entre les établissements scolaires. L'étude PISA et les questions qui y sont posées reflètent les préoccupations et les attentes du monde économique, avant les critères non économiques de l'enseignement, comme la transmission d'une culture générale et la faculté de former des citoyens émancipés ou encore la résolution de problèmes de société. Rien d'étonnant par ailleurs que dans le peloton de tête figurent les pays qui depuis pas mal d'années ont adopté un enseignement basé sur la pédagogie des compétences.
On peut aussi faire valoir des doutes sérieux quant à la comparabilité des données statistiques lorsque celles-ci proviennent de situations très divergentes en matière de population scolaire. Est-il opportun par exemple de comparer les performances des élèves du système scolaire finlandais, qui compte un faible pourcentage d'enfants immigrés, avec celles du système luxembourgeois où ce pourcentage est très élevé? Dans le même ordre d'idées, la comparaison des performances de différents Etats a-t-elle un sens?
Ne faudrait-il pas plutôt se focaliser sur des régions avec des caractéristiques semblables et comparer ce qui est comparable?
Nonobstant ces réflexions, les principaux résultats - divergents et concordants - des études PIRLS et PISA 2007 méritent d'être étudiés et commentés.
Les résultats divergents du Luxembourg dans les deux tests
Il faut noter d'abord que les résultats des deux tests affichent un certain nombre de différences, résumées dans le tableau suivant.
|
|
|
|
|
|
|
|
Quelques commentaires s'imposent dès à présent:
- Les résultats des deux tests divergent fortement au niveau des performances de lecture: au bon classement des élèves dans PIRLS s'oppose un mauvais classement dans PISA.
L'âge des élèves testés peut être un facteur d'explication de cette divergence, puisque dans PIRLS, les enfants ont été testés en 5e année d'études au Luxembourg, au lieu de la 4e année dans la plupart des autres pays. Dans PISA par contre, il n'a pas été tenu compte de l'argument linguistique (retard dû à l'apprentissage simultané de deux langues étrangères) et les élèves ont été testés à l'âge de 15 ans. Cette réflexion peut être prolongée: du fait des cours de langues plus nombreux, l'impact des branches scientifiques dans le curriculum de l'enseignement postprimaire luxembourgeois est moindre que dans les autres pays et ainsi les élèves sont forcément moins bien préparés aux questions en relation avec les mathématiques et les sciences naturelles.
D'autres facteurs d'explication pourraient résulter du caractère différent des classes dans les deux ordres d'enseignement:
- dans le primaire, les effectifs des classes sont assez réduits et l'instituteur ou l'institutrice joue un rôle très fort de personne de référence pour réguler l'apprentissage, alors que dans le postprimaire, les élèves se retrouvent dans des classes plus peuplées et voient défiler de nombreux enseignants dont l'influence est alors réduite; à cette perte d'influence de l'enseignant s'ajoute l'entrée dans l'âge de la puberté avec tous les problèmes que cela implique;
- l'hétérogénéité des classes du primaire permet probablement une stimulation plus forte des élèves faibles que dans le postprimaire où ceux-ci se retrouvent entre eux, notamment dans les classes du régime préparatoire de l'EST.
A partir de la 5e année d'études du primaire le vocabulaire «explose» et les enfants qui ne trouvent pas de support à l'extérieur de l'école perdent rapidement pied, surtout lorsqu'ils ont déjà rencontré des problèmes au cours des premières années. - L'attitude négative face à la lecture (et à l'école dans l'ensemble) des enfants testés dans PIRLS ne doit pas étonner, en raison de la pression qui est exercée sur eux dès la première année de l'école primaire. Notre enseignement pèche par des programmes surchargés du fait notamment de l'apprentissage simultané de deux langues. L'instituteur ou l'institutrice peut rarement consacrer du temps à la détente et à la «lecture pour le plaisir»: le programme doit être terminé!
- Expliquer l'écart de performance entre les garçons et les filles dans PISA revient à prendre en considération de nombreux éléments psycho-sociaux. Une analyse dans ce domaine complexe est matière pour spécialistes.
Les résultats concordants du Luxembourg dans les deux tests
PIRLS
Suivant cette étude, la relation entre l'origine sociale et les compétences en lecture est particulièrement forte; il y existe une corrélation élevée entre la formation scolaire des parents et les performances de leurs enfants en lecture. A noter que 17,7 % des parents consacrent moins d'une heure par semaine à la lecture; ils font ainsi en quelque sorte figure de mauvais modèle pour leurs enfants.
Les différences y sont significatives aussi entre les résultats des élèves luxembourgeois et ceux des élèves d'origine Etrangère, surtout si les deux parents sont nés à l'étranger.
L'étude relève aussi un taux très important d'élèves au-dessus de l'âge normal et constate une augmentation de l'écart de performance négatif de ces élèves.
PISA
Voyons d'abord les conclusions de l'étude au niveau des performances des élèves suivant leurs origines.
L'étude montre une corrélation élevée entre les performances aux épreuves et le statut socio-économique4.
Voici les différences de performances entre élèves « favorisés » et «défavorisés»:
- Compréhension de l'écrit:
101 pts, soit plus de 2,5 années de scolarité5 - Culture mathématique:
89 pts, soit plus de deux années scolaires - Culture scientifique:
98 pts, soit plus de 2,5 années scolaires.
La corrélation entre le lieu de naissance et les performances aux épreuves PISA est élevée aussi.
Voici les différences de performances entre élèves natifs et étrangers, qui figurent parmi les plus fortes au niveau international:
- Compréhension de l'écrit:
78 pts - Culture mathématique:
63 pts - Culture scientifique:
82 pts
À raison des 38 points sur l'échelle PISA correspondant à 1 année scolaire, les élèves étrangers accuseraient donc un retard de 1,5 à 2 années scolaires selon les compétences évaluées.
L'étude établit aussi un lien entre la langue parlée à la maison et le fait d'être un élève «favorisé» ou «défavorisé» 6.
La langue parlée à la maison est un facteur qui permet d'identifier sur le plan socio-économique l'origine culturelle des «élèves défavorisés».
- parmi ceux-ci figurent 52 % d'élèves romanophones, 36 % d'élèves germanophones et 12 % d'élèves qui ne sont ni l'un, ni l'autre,
- par contre, parmi les élèves «favorisés», on compte 85 % d'élèves germanophones, 10 % d'élèves romanophones et 5 % d'élèves originaires d'une autre communauté linguistique.
L'étude fait état des effets cumulatifs du lieu de naissance, du statut socio-économique et de la langue parlée à la maison.
Elle note: «Lorsqu'on considère les trois facteurs ensemble, et en prenant comme point de départ un élève «défavorisé», «étranger» et parlant une langue non-germanophone à la maison, la différence par rapport à un élève «favorisé», «natif» et ayant un arrière-fond linguistique germanophone s'élèverait à 135 (compréhension de l'écrit), 115 (mathématiques) et 135 (sciences) un écart qui équivaut à une avance de trois (en mathématiques), voire 3.5 années scolaires au Luxembourg. 7
Le graphique suivant illustre cela:
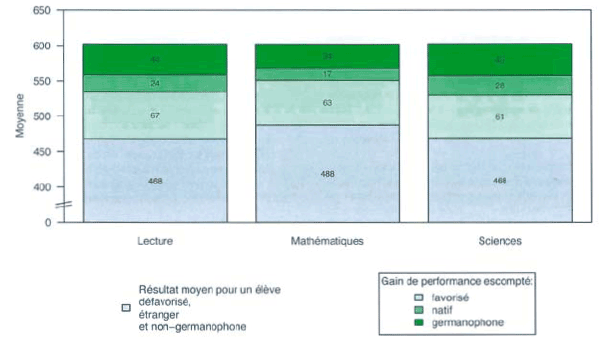
Effets isolés du lieu de naissance des élèves, de leur statut socio-économique et de la langue parlée à la maison sur les échelles de compréhension de l'écrit, de culture mathématique et de culture scientifique (en points).
Considérons à présent les conclusions majeures de l'étude quant au système scolaire luxembourgeois!
a) Voici la répartition des élèves «favorisés/défavorisés» et «natifs/étrangers» sur les trois types d'enseignement8:
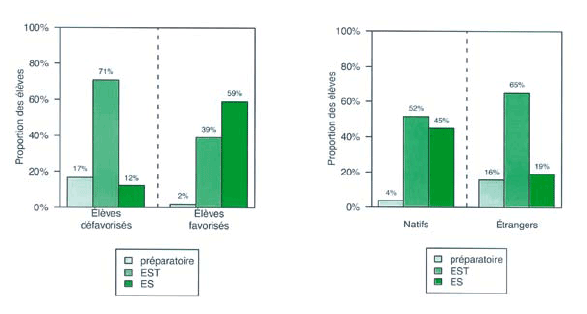
b) Suivant qu'ils sont «défavorisés» ou «favorisés» ou bien «étrangers» ou «natifs», les élèves accusent un retard scolaire plus ou moins élevé9:
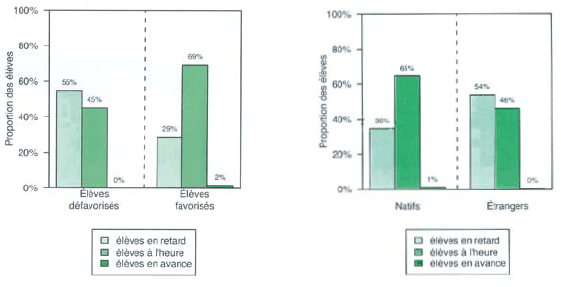
A noter que d'une manière générale, le retard scolaire est élevé et qu'il varie fortement selon le type d'enseignement. Le graphique suivant10 montre p.ex. que 48+18=62 % des élèves du régime préparatoire ont déjà redoublé une ou plus d'une fois dans l'enseignement primaire et que 21+2=23% des élèves du régime préparatoire redoublent aussi une ou plus d'une fois dans l'enseignement secondaire (technique).
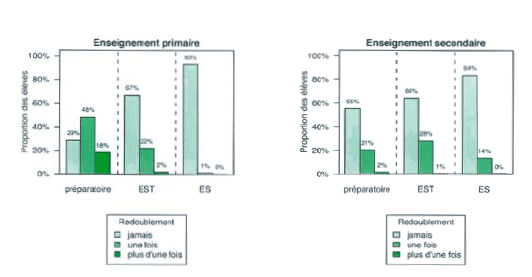
Fréquence du redoublement par type d'enseignement au primaire et au secondaire.
c) Suivant le «contexte d'immigration» et le «statut social» les élèves sont répartis comme suit à l'intérieur de l'enseignement postprimaire11:
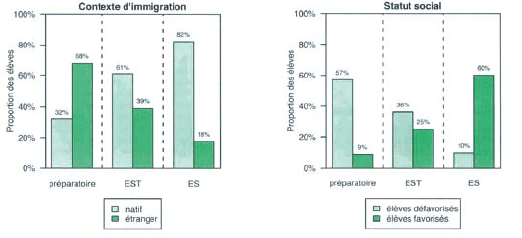
d) Les scores moyens obtenus aux épreuves PISA diffèrent fortement suivant le type d'enseignement12:
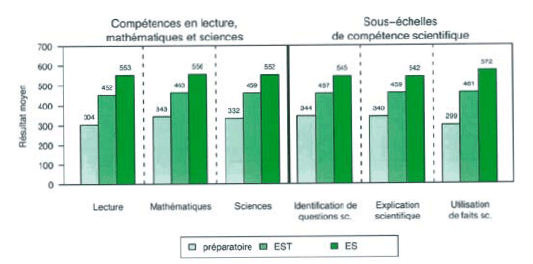
Compte tenu encore des 38 points sur l'échelle PISA correspondant approximativement aux savoirs et savoir-faire acquis en une année scolaire, on s'aperçoit que les écarts entre l'ES et l'EST sont de l'ordre de deux ans à deux ans et demi. L'écart est encore plus important entre le préparatoire et l'EST puisqu'il se chiffre à trois ans jusqu'à trois ans et demi.
A l'âge de 15 ans, on noterait donc suivant PISA un retard ES-RP de l'EST de l'ordre de 5 à 6 ans en moyenne!
d) Les différents lycées et lycées techniques sont équivalents au niveau de la performance des élèves. Suivant les résultats de l'étude PISA, les écarts en Lecture, en Mathématiques et en Sciences entre établissements s'expliquent à raison de 98-99 % par le type d'enseignement ainsi que par les caractéristiques des élèves (sexe, âge et statut social des parents). Peu importe donc le lycée/lycée technique, l'étude accorde aux élèves les mêmes chances de réussite dans leur filière.
L'étude a fait une analyse particulière des résultats des élèves des classes PROCI (Projet cycle inférieur) de l'EST. Elle note qu'il n'y a pas eu de comparaison PROCI/Non-PROCI à l'intérieur des six établissements associés au projet à cause de la taille souvent très inégale des deux groupes. Tous les élèves PROCI (de 15 ans) de l'EST ont donc été comparés avec tous les élèves non PROCI de la même filière. Après neutralisation des différences entre les deux groupes (surtout proportion de garçons plus importante dans les classes PROCI), il s'est avéré que les élèves PROCI ont obtenu de meilleurs résultats dans le test PISA que leurs camarades non-PROCI. Le graphique suivant13 fait ressortir les différences:
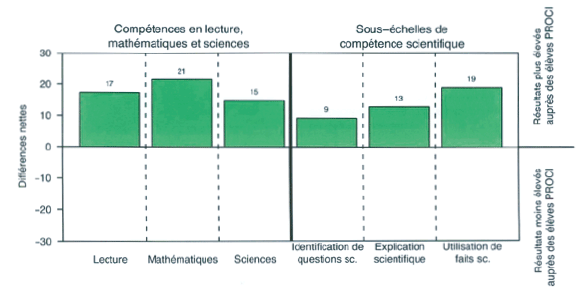
Commentaire des résultats et revendications
Les résultats concordants des deux études PIRLS et PISA pointent dans la même direction: l'enseignement luxembourgeois ne parvient pas à niveler les différences socio-économiques, mais les reproduit.
Le phénomène n'est pas nouveau; l'étude MAGRIP (MATière Grise Perdue), menée dans les années 1970, tout comme les deux études PISA précédentes ont abouti à des résultats comparables.
Un tel constat négatif appelle d'un côté un certain nombre de remarques restrictives quant à l'interprétation des résultats et de l'autre des revendications pour refaire de l'école un ascenseur social pour l'ensemble de la population et dans l'intérêt de l'économie.
Quelques remarques restrictives d'abord
- - Il convient de ne pas surestimer le classement réalisé par PISA. Comme Fred van Leeuwen, le Secrétaire général de l'Internationale de Education vient de le dire récemment, «PISA ne peut offrir qu'un instantané de la manière dont un groupe d'élèves d'une quinzaine d'années répondent à un ensemble de questions. Il ne donne pas, et ne peut pas donner, une image complète et nuancée de l'éducation dans aucun pays». Il a exhorté les parents et les décideurs à lire de tels rapports d'un oeil sceptique. «Les complexités de l'éducation ne peuvent pas être réduites à des scores sportifs, dans lesquels certains enfants sont décrits comme des gagnants et d'autres comme des perdants». Et d'ajouter qu'il est «préoccupant de voir les gouvernements nationaux mettre en oeuvre des réformes de l'éducation avec l'objectif déclaré de se classer plus haut dans PISA. De tels objectifs superficiels sont profondément menaçants pour la qualité de l'éducation et l'accès à l'éducation pour tous.».
Nous référant aux résultats obtenus par le Luxembourg, on pourrait se poser la question, quel score nos élèves auraient obtenu, s'ils avaient été testés à 16 ans. On peut aussi se demander si la proposition un peu rapide de la ministre de l'Education nationale consistant à introduire l'enseignement de la physique et de la chimie dès la classe de 7e0 - avec l'espoir d'obtenir de meilleurs résultats dans le prochain test -est opportune. Il est clair en effet que cela se fera au détriment du temps dévolu à d'autres branches. Lesquelles ? - En matière linguistique, le Luxembourg se trouve dans une situation peu enviable: bien qu'une grande partie des enfants du primaire provienne de familles d'immigrés romanophones, qui rencontrent des problèmes avec l'apprentissage de l'allemand, il est pourtant exclu d'organiser une filière francophone dès la première année d'études, sous peine de perdre l'élément intégrateur constitué par l'école. Il faut donc vivre avec cette contradiction et l'aménager au mieux. Un test comme PISA ne peut tenir compte de cette situation exceptionnelle.
- Les protagonistes OCDE/PISA ont tendance à vendre les réformes qu'ils proposent (l'enseignement par compétences, l'autonomie des établissements scolaires et la concurrence entre les écoles) comme des remèdes miracles contre des maux dont l'origine est avant tout socio-économique. Il ne s'agit pas pour nous de rejeter ici l'enseignement par compétences ou l'autonomie des établissements, mais d'insister que cela n'augmentera pas les chances des «élèves défavorisés», bien au contraire.
- Une mise en garde quant à l'interprétation des constats sociologiques des études PIRLS et PISA s'impose: corrélation n'est pas synonyme de relation causale: un élève ne se trouve pas dans une classe du régime préparatoire, parce que ses parents sont des immigrés roumanophones qui ne parlent pas le luxembourgeois, qui exercent un métier manuel et qui ne lisent pas suffisamment. Etablir une telle relation reviendrait à culpabiliser les parents. Etablir la relation inverse reviendrait à du déterminisme social et servirait d'excuse à l'inaction des responsables politiques.
des revendications ensuite
Une bonne formation scolaire est de nos jours essentielle, tant pour l'individu que pour la société. L'inégalité des chances n'a pas seulement des conséquences individuelles graves, mais elle mine l'avenir économique et social dans son ensemble. Il est dès lors insoutenable qu'une partie importante de la population scolaire, qu'elle soit luxembourgeoise ou immigrée, se trouve en situation d'échec ou soit orientée vers des formations de pacotille.
Les revendications essentielles qui résultent d'un tel constat sont à mettre en relation avec deux phénomènes importants, qui ont progressivement changé la donne depuis une trentaine d'années.
- Il y a d'une part le phénomène migratoire: il colle à l'histoire du Luxembourg comme une seconde peau. N'est-ce pas la sidérurgie luxembourgeoise qui a été mise en place par des cadres allemands et des ouvriers italiens? N'est-ce pas le secteur de la construction qui dépend de la force de travail des ouvriers portugais depuis les années 1970? Or, traditionnellement, les responsables politiques ne s'intéressaient guère à la formation des immigrés. Soit ceux-ci étaient des travailleurs migrants sans famille, soit ils étaient formés dans leur pays, soit ils n'avaient pas besoin de formation professionnelle et ils étaient formés sur le tas, au contact du métier. Ce qui fait que les responsables politiques sont restés passablement inactifs pendant des décennies face aux difficultés que les enfants de ces immigrés rencontraient dans le système scolaire luxembourgeois. Ce n'est que vers la fin des années 1990 que face à la nécessité de mieux former un maximum de personnes, qu'une prise de conscience a eu lieu et que des mesures plus conséquentes ont été décidées, notamment à travers l'introduction d'un enseignement précoce. Il s'agissait de donner une base dans la langue luxembourgeoise aux enfants d'immigrés afin qu'ils puissent commencer l'étude de l'allemand sous de meilleures conditions à l'école primaire. Les résultats de l'enseignement précoce et de l'enseignement préscolaire restent néanmoins limités. Suivant l'étude PIRLS, le précoce et le préscolaire ne parviennent pas à préparer le nombre élevé de primo-arrivants à entrer dans l'école primaire: 12,5 % des enfants n'ont pas fréquenté le préscolaire et lors de leur entrée en 1re année d'études primaires, 18 % des élèves étaient unilingues et ne savaient parler ni le luxembourgeois, ni l'allemand14.
- à travers l'introduction d'un enseignement précoce. Il s'agissait de donner une base dans la langue luxembourgeoise aux enfants d'immigrés afin qu'ils puissent commencer l'étude de l'allemand sous de meilleures conditions à l'école primaire. Les résultats de l'enseignement précoce et de l'enseignement préscolaire restent néanmoins limités. Suivant l'étude PIRLS, le précoce et le préscolaire ne parviennent pas à préparer le nombre élevé de primo-arrivants à entrer dans l'école primaire: 12,5 % des enfants n'ont pas fréquenté le préscolaire et lors de leur entrée en 1re année d'études primaires, 18 % des élèves étaient unilingues et ne savaient parler ni le luxembourgeois, ni l'allemand15.
Sans être spectaculaires, les revendications qui suivent visent le long terme; nombre d'entre elles rejoignent celles de la Conférence éducation et formation de l'OGB-L d'octobre 199816:
- Il est primordial d'encourager les enfants dès leur plus jeune âge et de les aider à maîtriser les difficultés qu'ils rencontrent. Cela implique l'emploi de personnel éducatif qualifié notamment dans l'enseignement précoce. Il s'agit de communiquer aux enfants un vocabulaire riche et de les stimuler au mieux.
- Au cours des premières années de l'école primaire, il faut pousser l'enseignement différencié et aider les enfants en difficulté. Ce sont les premières années qui sont essentielles pour le développement scolaire.
- L'implication des parents dans l'éducation scolaire de leurs enfants est à encourager en leur permettant de faire des apports concrets.
- L'apprentissage du luxembourgeois par les parents devrait être encouragé, notamment en l'incluant dans le temps de travail.
- Il faut engager suffisamment de personnel enseignant dûment qualifié à la fois dans l'enseignement primaire et postprimaire; et offrir une formation aux chargés de cours en place.
- Dans le cycle inférieur de l'enseignement postprimaire, des équipes de base par classe sont à créer, qui se concertent régulièrement, et qui prennent en charge, ensemble avec le SPOS, une orientation plus conséquente des élèves et qui coopèrent avec les écoles primaires en vue d'un meilleur passage primaire -postprimaire.
- Dans les deux ordres d'enseignement, une offre de journée prolongée avec des activités péri- et parascolaires, assurées par un personnel éducatif dûment qualifié est à mettre en place dans l'ensemble du pays.
- Dans tous les ordres d'enseignement, les programmes doivent être allégés et viser l'essentiel, de façon à ce qu'ils garantissent la maîtrise des connaissances et des savoir-faire fondamentaux; parallèlement des méthodes d'enseignement diversifiées favorisant l'autonomie et la responsabilité des enfants et des jeunes sont à mettre en oeuvre.
- Dans tous les ordres d'enseignement, l'évaluation formative est à promouvoir.
- Pour pouvoir mettre en oeuvre un enseignement différencié, appliquer des méthodes actives de construction du savoir, du savoir-faire et du savoir-être des élèves, recourir à un contrôle continu et à une évaluation formative doublée d'une remédiation, les effectifs de classe élevés qui existent actuellement surtout dans l'enseignement secondaire, mais aussi en partie dans l'enseignement secondaire technique doivent absolument être réduits.
Je voudrais finalement relancer le débat autour d'un tronc commun pour tous les élèves jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire. Deux indices significatifs me font plaider dans cette direction: les excellents résultats réalisés dans le cadre de l'étude PIRLS dans les classes hétérogènes de l'enseignement primaire et les fort bons résultats à l'occasion du test PISA obtenus par les élèves des classes PROCI. Il me semble que la stimulation réciproque des différents membres de la classe hétérogène constitue un élément positif fondamental, qu'il faut mettre en valeur à travers une bonne préparation pédagogique des enseignants quant aux méthodes ou techniques de différenciation interne.
Il est vrai que l'évaluation quantitative du projet PROCI avait produit des résultats mitigés17.
Il est vrai aussi que des écarts de performance énormes séparent actuellement les élèves du régime préparatoire de ceux de l'enseignement secondaire et il est exclu pour le moment d'envisager une classe commune avec ces deux types d'élèves. Mais cela n'implique pas qu'il faut persévérer ad infinitum dans la voie actuelle du classement des élèves dans différents «tiroirs», laissant les faibles sur le bord de la route et poursuivant le programme avec ceux qui savent se débrouiller, notamment parce qu'ils bénéficient du soutien de leur environnement familial. Face aux défis de la société de la connaissance, je pense au contraire que le moment est venu de viser une réelle égalité des chances par l'intermédiaire d'une nouvelle qualité de l'enseignement. C'est à la fois une question de volonté des responsables politiques, de moyens mis à la disposition des écoles et d'engagement des enseignants.
Guy Foetz
Vice-président du SEW
1 PIRLS 2006, Lesekompetenzen Luxemburger Schülerinnen und Schüler auf dem Prüfstand, Ch. Berg, W. Bos, S. Hornberg, P. Kühn, P. Reding, R. Valtin:, Waxmann, 2007, Münster
2PISA 2006, Rapport national Luxembourg, MENFP/SCRIPT/Université du Luxembourg/Unité de Recherche EMACS, 2007
3Document disponible sur le site www.sew.lu
4Dans le test PISA, le statut socio-économique (SSE) de la famille a été appréhendé par l'intermédiaire du statut professionnel des parents. Les données fournies par les élèves (questionnaire) ont été codées pour conduire à l'élaboration d'un indice qui varie de 0 (SSE faible) à 90 (SSE élevé). Avec 47 points, le SSE moyen au Luxembourg se situe légèrement au-dessous de la moyenne des pays de l'OCDE (49 points). Le groupe des élèves socio-économiquement favorisés rassemble ceux dont le SSE se situe au-dessus de 51,5 points (postes à responsabilité dans les services tels qu'ingénieur, médecin, professeur d'université ou avocat) et celui des élèves socio- économiquement défavorisés rassemble ceux dont le SSE se situe au-dessous de 33,5 points (profession de cultivateur, d'ouvrier métallurgiste, de mécanicien, de conducteur de taxi, de routier ou de serveur). Suivant ces indices, le Luxembourg comporte 24 % d'élèves défavorisés et dépasse légèrement (en sens négatif) la moyenne internationale.
5A raison de 38 points sur l'échelle PISA correspondant aux savoirs et savoir-faire acquis en une année scolaire.
6Pour la définition des notions «élèves favorisés» et «élèves défavorisés», voir la note (3).
7PISA 2006 - Rapport national Luxembourg, p. 43
8PISA 2006 - Rapport national Luxembourg, p. 40. Le régime préparatoire de l'EST est considérée ici comme un type d'enseignement à part.
9Ibidem (6), p. 41.
10Ibidem (6), p. 57.
11Ibidem (6), p.56
12Ibidem (6), p.59.
13Ibidem (6), p.67.
14Ibidem (1), p.201.
15Voir à ce sujet le livre intéressant de Philippe Mérieux: Pédagogie: le devoir de résister, ESF éditeur, 2007.
16Ibidem (3).
17D'un côté, dans les épreuves communes, les élèves PROCI avaient obtenu de bien meilleurs résultats en Mathématiques que les élèves non-PROCI; ceci semble se confirmer au niveau des épreuves PISA.
De l'autre côté
- le projet avait augmenté le nombre des élèves quittant prématurément l'école
- contrairement aux attentes des protagonistes du projet, PROCI a été moins favorable aux élèves faibles
- moins d'élèves ont été orientés vers la 10e technique et plus d'élèves vers la 10e technicien, voire la 10e professionnelle
- le nombre d'élèves qui ont redoublé la 9e pour passer à une classe de 10e de leur choix (d'un niveau de formation supérieur) était encore plus élevé dans les classes PROCI que dans les classes non-PROCI.
Voir à ce sujet l'article «Évaluation du projet pilote cycle inférieur - Des résultats mitigés qu'il faudra analyser davantage», paru dans le SEW-Journal no 3-2007.
